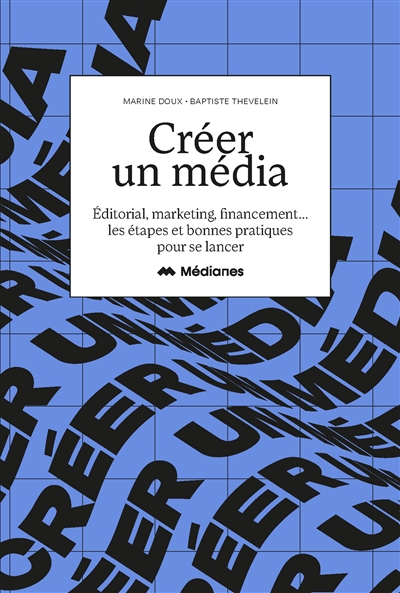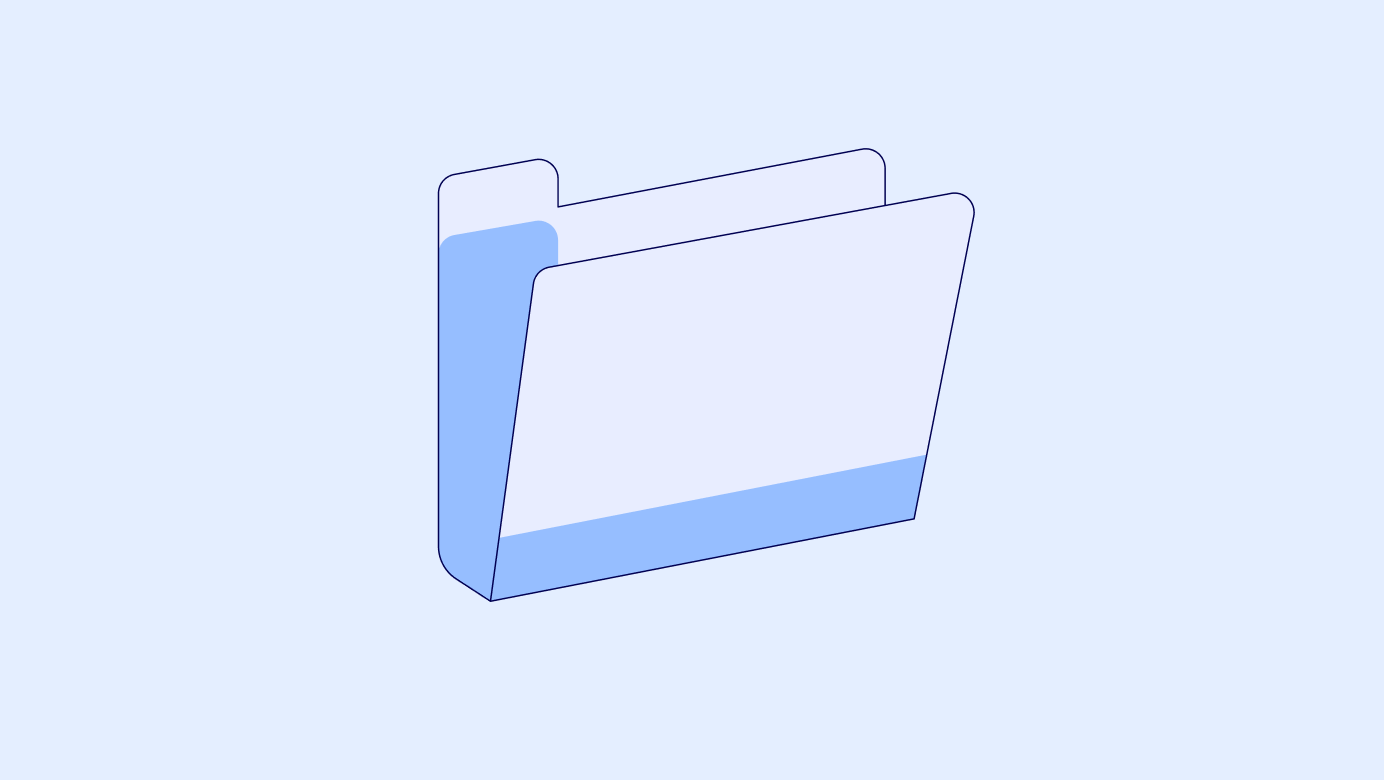
Pourquoi l’archivage est essentiel à l’indépendance des médias
Le web a décuplé la portée du journalisme mais a également fragilisé sa mémoire. Exposés aux aléas techniques, aux pressions politiques et financières, des années de travail peuvent disparaître sans laisser de trace. Dans ce contexte, archiver devient un geste de résistance.
Au fil des années, j’ai travaillé dans des rédactions où retrouver un article signifiait fouiller dans des armoires d’archives, parmi des numéros cornés ou jaunis, parfois miraculeusement intacts. Quand mes textes étaient imprimés, je pouvais en conserver un exemplaire et, aujourd’hui encore, je sais qu’ils existent quelque part. Les retrouver peut s’avérer laborieux, mais ces articles m’appartiennent véritablement et ne peuvent disparaître que par ma propre négligence.
Pour mes articles publiés en ligne, c’est une autre histoire. Si quelques mots-clés tapés dans un navigateur suffisent à en faire ressurgir la majorité, leur sort m’échappe complètement. Hébergés sur des disques durs ronronnant dans des serveurs dont je serais incapable de pointer la localisation ou de nommer le propriétaire, ils peuvent disparaître sans laisser de trace. C’est un problème pour moi, journaliste, mais aussi pour l’indépendance de la presse et le droit à l’information.
Disparitions silencieuses, pertes massives
On pense toujours que cela n’arrive qu’aux autres… jusqu’au jour où ça nous tombe dessus. Des médias comme Game Informer ou The Messenger ont fermé brutalement, emportant avec eux des années de journalisme. Quand Vice était sur le point de fermer ses portes, ses salarié·es se sont rué·es sur la fonction « Enregistrer en PDF » pour sauver ce qui pouvait l’être, comme le rapporte le Nieman Lab. Non pas par nostalgie, mais pour sauvegarder le fruit de leur travail. Car sans archivage, pas de portfolio et donc pas de levier pour rebondir une fois de retour sur le marché de l’emploi. Ce n’est pas qu’une question de rachats ou de faillites : cyberattaques, pannes ou simples changements de CMS suffisent à faire disparaître des larges quantités de contenus. Internet Archive, qui documente le web depuis 1996, fait notamment l’objet d’attaques répétées et doit renforcer ses défenses numériques.
La menace est aussi politique. En 2023, El Periódico (Guatemala) a cessé de paraître suite à des pressions politiques et économiques. Son site web n'est resté en ligne que trois jours, faute de ressources pour maintenir les serveurs en ligne. Aux États-Unis, des décrets de Donald Trump ont conduit à la suppression de milliers de pages sur des sites fédéraux, dont certaines contenaient des informations cruciales concernant la santé publique ou le changement climatique. Si des informations éminemment d'intérêt public (préservées depuis par des archivistes) peuvent être effacées d’un trait de plume, pourquoi la presse y échapperait-elle ?
L’archivage pour l’indépendance et le droit à l’information
Le web donne l’illusion de l’éternité. Une croyance trompeuse et loin d'être anodine qui nous détourne des pratiques essentielles à la conservation de nos contenus numériques, pourtant bien plus vulnérables que nous ne l'admettons. Organiser un autodafé, c’est laborieux, bruyant, et peu discret. Débrancher un serveur, en revanche, est simple, radical et invisible. Comme le souligne la chercheuse Megan Sapnar Ankerson : « Il est bien plus facile de retrouver un film de 1924 qu’un site web de 1994. »
Nous ne laisserions pas le soin à Amazon de gérer et de préserver pour l’avenir l’ensemble de nos livres, journaux et magazines, pourtant, nous entreposons sans trop nous alarmer nos articles sur dans des hangars numériques dont nous ne contrôlons rien. Une dépendance dangereuse créant des locataires précaires, accommodés de cette dépossession organisée. Dans cette configuration, l’archivage devient une condition essentielle de l’indépendance.
L'archivage constitue également un devoir fondamental envers les lecteur·ices, acteur·ices essentiel·les de la presse indépendante par leur engagement, leurs abonnements et leurs dons. Peut-on les priver des contenus qu’ils·elles ont permis de faire exister, simplement parce qu’un site ferme ou qu’une entreprise change de priorité ? Peut-on conditionner l’accès libre à une information d'intérêt publique à des arbitrages commerciaux, des contraintes techniques et des logiques purement capitalistes ?
Une urgence concrète
L’archivage n’est pas qu’un problème pour l’avenir. Il nous touche déjà. Le phénomène du « link rot », ou érosion des liens, fragilise déjà notre patrimoine numérique. Selon le Pew Research Center, un quart des pages web ayant existé entre 2013 et 2023 sont aujourd’hui inaccessibles. Une étude sur le New York Times révélait que 25% des liens utilisés dans ses articles redirigeant vers une page spécifique étaient corrompus. L'archivage concerne tout l'écosystème web, pas uniquement les médias. Il s'agit de préserver sur le long terme la valeur des contenus journalistiques qui perdent en crédibilité quand leurs références disparaissent.
Comme l’explique Vladimir Tybin à propos de l’archivage des Skyblog à la BnF : « On ne sait pas ce qui va intéresser les chercheurs dans 10, 20, 30, 50 ans.». Du billet anecdotique à l’enquête de fond, tout peut devenir archive. Le journalisme ne se limite pas non plus aux articles publiés sur un site : carrousels Instagram, vidéos TikTok, threads X, newsletters… Ces formats jouent un rôle crucial et croissant dans la transmission de l'information, mais ils sont aussi les plus vulnérables, hébergés sur des plateformes privées soumises à des logiques commerciales et à une politique de modération arbitraire et volatile.
Un enjeu négligé, une responsabilité à prendre
Si Internet a permis une explosion inédite de nouveaux médias, il a aussi engendré la constitution de la collection la plus fragile de reportages, d’enquêtes et d’interviews. Une étude du Tow Center (datant de 2019) montrait par exemple que 19 des 21 rédactions étudiées n’avaient aucune mesure de préservation. En cause : une illusion tenace d’éternité numérique, couplée à la croyance qu’un hébergement sur un CMS comme Wordpress ou dans un Drive suffisait à garantir la pérennité des contenus. Or, stocker n’est pas archiver. L’archivage implique de mettre en place des protocoles rigoureux et une vision à long terme pour garantir un accès durable, résistant aux bouleversements technologiques et aux tentatives d'effacement motivées par des intérêts politiques ou économiques. Si des initiatives comme Internet Archive accomplissent un travail fondamental de préservation, elles ne peuvent porter seules le fardeau de la mémoire numérique comme le souligne l'organisation dans son dernier rapport. L’archivage du web requiert une mobilisation collective, large et active.
Comment faire ?
Nous avons listé, ci-dessous, quelques recommandations pour amorcer une politique d’archivage :
- Établir des protocoles de transparence pour la suppression ou modification d'articles
- S’assurer d’être inclus dans les collectes de la BnF ou les solliciter.
- Ne pas laisser une page 404 vide en cas de suppression d’un article : expliquer la raison de cette absence.
- Prévoir un plan de fermeture anticipée du site, et le communiquer à vos lecteur·ices afin de leur explique ce qui arrivera aux contenus sur le site devait un jour fermer.
- Désigner une personne référente sur les questions d’archivage.
- Installer l’extension d’Internet Archive pour archiver rapidement et facilement des pages.
- Tester en interne sa capacité à retrouver ses propres contenus (vidéos, photos...)
- Utiliser des outils de liens permanents pour les sources externes.
Ressources utiles pour aller plus loin :
- Lire l'étude de l'Université du Missouri sur la préservation du journalisme en ligne
- Découvrir les observations et les recommandations du Tow Center.
- Consulter ce guide du GIJN pour la conservation des travaux journalistiques
- Se plonger dans cette compilation de nombreux guides et outils pour archiver Internet.
Si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez vous abonnez à la newsletter des 10 liens dans laquelle nous partageons régulièrement des outils et des ressources à ce sujet 📩
La newsletter de Médianes
La newsletter de Médianes est dédiée au partage de notre veille, et à l’analyse des dernières tendances dans les médias. Elle est envoyée un jeudi sur deux à 7h00.