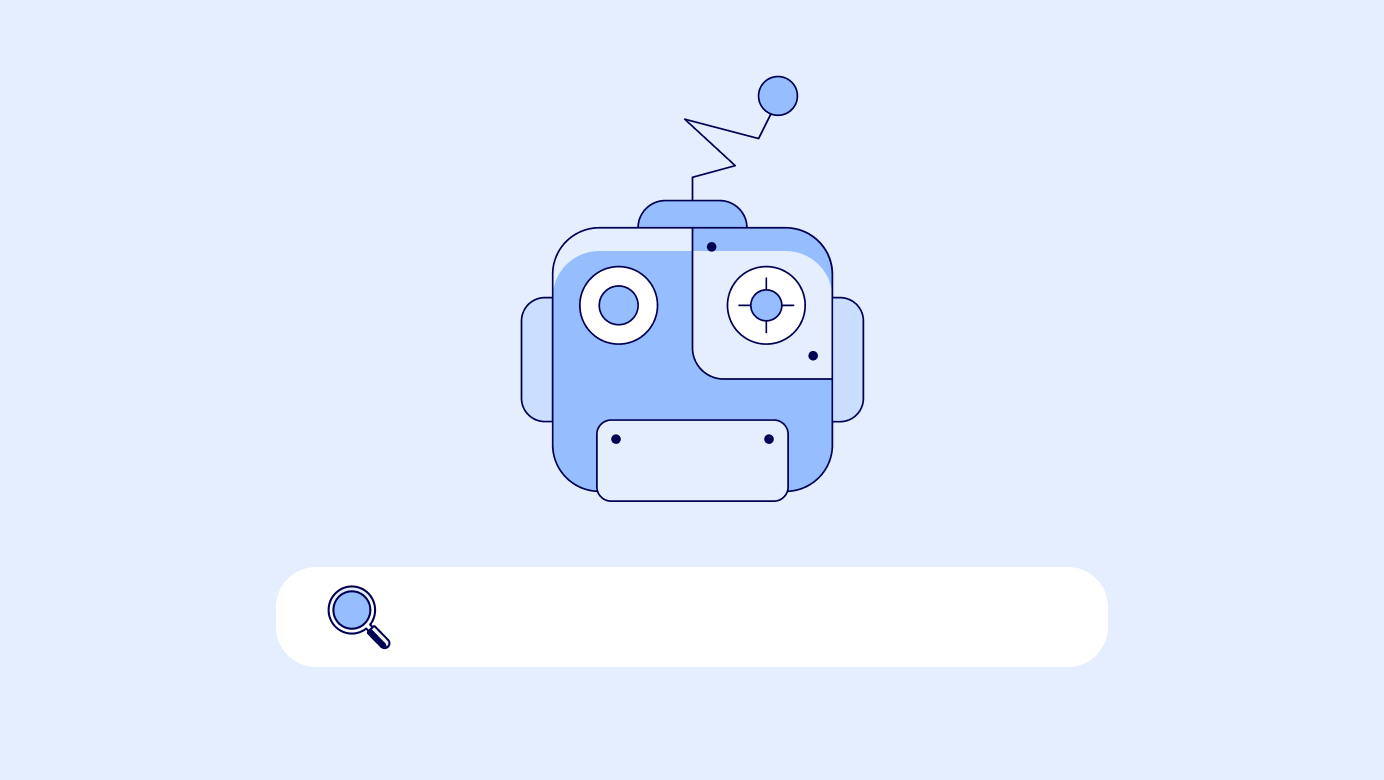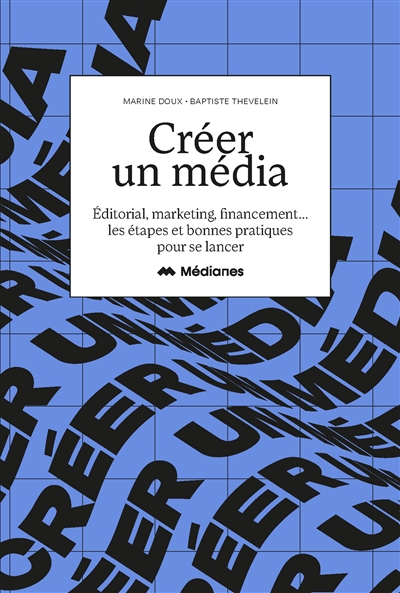Internet nous échappe, comment se le réapproprier ?
Algorithmes imprévisibles, effondrement du trafic, dépendance aux plateformes : les médias se retrouvent piégés par un Internet qu’ils ne maîtrisent plus. Comment préserver leur lien avec leur audience ? Tour d’horizon des initiatives en cours.
Ces derniers mois, journalistes et rédactions ont débattu de leur présence sur X face aux dérives de son propriétaire. Faut-il partir ou rester ? Certaines ont déjà levé les voiles pour d’autres horizons tandis que d'autres hésitent, tiraillées entre les besoins de leur audience et les dérives d'un réseau social qui ne les respecte plus. Sur le fond toutefois, le constat de la presse est unanime : les grandes plateformes ne sont ni des alliées ni des partenaires fiables, X n’étant qu’un exemple parmi tant d’autres. L’époque où Facebook et Twitter courtisaient la presse avec trafic et partenariats est révolue. Désormais, la confiance entre ces deux secteurs, qui se sont pourtant longtemps nourris l’un de l’autre, est plus que fragile.
Une rupture qui se manifeste, par exemple, par le refus de Meta de rémunérer la presse au Canada, allant jusqu'à bannir les contenus médiatiques de ses plateformes. Récemment, Mark Zuckerberg a mis fin aux doutes sur l’importance qu’il accorde à une information de qualité sur ses plateformes en coupant court à des partenariats qui visaient à lutter contre la désinformation et en assouplissant ses règles de modération au détriment des femmes ou de la communauté LBGTQIA+. Parallèlement, Google redéfinit ses algorithmes au détriment des médias, entraînant des chutes de trafic et des tests inquiétants de suppression de contenus. Enfin, l'émergence des IA génératives comme ChatGPT, Perplexity ou Gemini bouleverse la circulation de l’information. Malgré les procès et les protestations d'une partie de la presse à l'encontre OpenAI et la façon dont la firme a exploité ses contenus, certains médias ont finalement opté pour des partenariats négociés individuellement et aux conditions parfois opaques.
Face à ces mutations, certaines rédactions s’inquiètent : comment maintenir des communautés engagées sans les réseaux sociaux ? Comment garantir du trafic sans Google ? Comment protéger leur contenu face aux IA qui agrègent et régurgitent l'information ? Et surtout, comment la presse indépendante peut-elle résister face aux géants du numérique aux ressources illimitées ?
Migrer vers des alternatives décentralisées
Contrairement à X ou à Meta, des plateformes adoptent une autre posture, semblant accueillir à bras ouverts la presse. Bluesky, qui entend ravir les déçu·es du muskisme, a multiplié les appels du pied à coup de fonctionnalités et de mots doux à l’attention de la presse. LinkedIn en a fait de même ces derniers mois en travaillant avec des centaines de rédactions à travers le monde et en déployant de nouveaux outils permettant de publier des newsletter ou des vidéos verticales. Pourtant, ces méthodes n’ont rien de nouveau. Meta, X, Google et consorts les avaient déjà employées avant de faire machine arrière quelques années plus tard. Même Substack, considéré un temps comme un refuge pour des journalistes en quête d'indépendance, a finalement déçu par son laxisme envers les contenus néo-nazis. Les médias sont-ils contraints de céder aux plateformes pour y diffuser leurs contenus, tout en croisant les doigts pour qu’elles ne leur fassent pas faux bond trop vite ?
L’histoire semble en tout cas se répéter et la presse se retrouve coincée dans des réseaux sociaux dont elle n'approuve plus les valeurs et les méthodes mais sur lesquels elle a bâti une communauté dont il est difficile de se séparer. Un problème auquel pourraient répondre des plateformes aux fonctionnements décentralisés, comme Mastodon ou Bluesky. À l’inverse de réseaux sociaux comme X ou Facebook, ils accorderaient davantage de pouvoir à ses utilisateur·ices sur leurs données, leurs contenus et leurs communautés. À l'instar des mails, la décentralisation des réseaux sociaux permettraient aux internautes d'échanger entre eux·elles depuis la plateforme de leur choix.

Le concept intéresse également de nombreuses rédactions, à l’image de The Verge ou de 404 Media, qui songent à fédérer leurs sites, permettant à leurs articles d’être consultés depuis plusieurs plateformes décentralisées. Concrètement, un·e utilisateur·rice de Mastodon pourrait, par exemple, commenter un article, et son message serait visible non seulement sur le site du média, mais également sur d’autres plateformes, comme Threads. Une telle approche unifierait des audiences jusque-là dispersées sur différents réseaux sociaux en une seule et même communauté. Elle réduirait aussi la dépendance aux plateformes traditionnelles et limiterait le risque de perdre une partie de son audience en cas de changement d’algorithme ou de fermeture soudaine d'un réseau social.
Même avec des alternatives décentralisées, partir des grandes plateformes reste pour l'instant un défi. « Une large partie de notre communauté est sur X, on y est pour l'instant. Je ne peux pas scier une branche en pleine campagne de dons pour que le site perdure » expliquait le cofondateur de StreetPress, Johan Weisz-Myara, à Arrêt sur images. La réussite de cette transition dépend donc de l'engagement du public, appelé à suivre les médias sur de nouvelles plateformes, à s’abonner à leurs newsletters et à les soutenir financièrement.
Renforcer les liens directs avec sa communauté (newsletters, flux RSS, paywalls réfléchis)
Face à la crise des intermédiaires, certains médias renforcent le lien direct avec leur audience en revenant à des outils que les réseaux sociaux entendaient pourtant ringardiser. Parmi les solutions désormais courantes figure la newsletter, permettant de contourner les algorithmes et d’atteindre les lecteur·ices avec moins de filtres. D’autres court-circuitent le processus traditionnel de distribution en mettant en place un flux RSS à l’image de 404 Media, permettant à ses abonné·es de lire l’intégralité de leurs contenus depuis leur agrégateur de choix, comme Feedly ou Netvibes.
Le flux RSS n’est qu’un des outils explorés par 404 Media qui a aussi instauré un mur exigeant une adresse mail pour consulter ses contenus. Une méthode qui lui permet d'assurer un contact direct avec ses lecteur·ices mais également de se protéger d'IA voraces. Une démarche récemment adoptée par plusieurs rédactions dont les contenus étaient pourtant accessibles gratuitement. Si ces paywalls offrent des revenus et une distribution indépendante des plateformes, leur multiplication interroge toutefois sur l’accès à une information de qualité pour toustes. Un dilemme dont a fait part The Verge lors de l’annonce de la mise en place d’un paywall partiel sur leur site.
Revenir au tangible : papier, ancrage local et diffusion physique
Pour l’instant, les solutions techniques ne sont pas toutes au point. La décentralisation des réseaux sociaux est encore balbutiante et certaines plateformes n’ont aucune alternative viable.« On est un peu profondément dans la merde pour être honnête », reconnaissait par exemple Jeannie Paterson, chercheuse en éthique numérique à l’Université de Melbourne, à propos de l'absence d’options pour remplacer Meta. Face à ces limites, certains médias réinvestissent l’espace physique pour diffuser leurs contenus. Pendant l’hiver 2023, The City (New York) a envoyé des cartes postales informant les habitant·es de leur droit au chauffage. L’année dernière, le média local The Texas Tribune a distribué des flyers et affiches sur la qualité de l’air dans les quartiers concernés par ses enquêtes.
À Marseille, Marsactu teste une diffusion locale en accès libre : avec Marsactu Illimité ses articles sont consultables gratuitement dans des cafés et centres sociaux via la connexion Wi-Fi. Au-delà de s’affranchir d’Internet pour la distribution de son travail, cette méthode permet à Marsactu de cibler géographiquement son audience, dont une partie manque de moyens, financiers comme techniques, pour consulter une information payante sur Internet.
D’autres médias en ligne misent sur le retour au papier. Splann! imprime certaines de ses enquêtes tandis que certaines rédactions vont plus loin, en lançant leur propres revues, livres ou magazines. The Verge a par exemple lancé « Content Goblins », une revue qui critique précisément la façon dont le journalisme et la culture sont partagés de façon ultra-optimisée sur Internet afin d’être consommés à la chaîne. Le papier n’est toutefois pas une formule magique. Si certaines rédactions ont fait le pari de faire revivre leur offre sur papier glacé, certaines publications peinent à suivre le cours du prix du papier, voire cessent complètement leur parution.
Développer ses propres plateformes
Plutôt que d’attendre de nouvelles alternatives, pourquoi ne pas en créer ? C’est précisément ce qu'avaient entrepris plusieurs médias en 2016, en lançant La Presse Libre, une plateforme d’abonnement groupé à des publications comme Arrêt sur images, Les Jours ou Alternatives Économiques. En 2022, toutefois, la plateforme cesse ses activités ; un coup dur pour les médias qui y participaient comme en témoignait ASI. Le concept d'une plateforme commune est toutefois loin d’être enterré. Il figure par exemple parmi les solutions avancées par Coop-médias, une coopérative qui entend soutenir l'indépendance de la presse, et le média Basta! propose depuis plusieurs années un Portail des Médias Libres qui regroupe les articles de divers médias sur une même plateforme. Basta! souhaite désormais lancer une nouvelle plateforme aux ambitions similaires. Certaines rédactions font également le pari d’investir davantage de moyens dans leurs propres sites plutôt que de dépendre de plateformes externes sur lesquelles elles n'ont pas la main. Pour fidéliser leur lectorat, habitué à s’informer sur TikTok ou X, ces médias n'hésitent pas à s'inspirer des fonctionnalités populaires des réseaux sociaux - comme les fils d'actualité dynamiques ou les vidéos au format vertical - en les intégrant directement à leurs sites. En adoptant cette approche, ces rédactions ne se contentent plus d’être des fournisseurs de contenu pour les réseaux sociaux, mais s’affirment comme des produits à part entière, porteurs d’une expérience complète et autonome, tout en s’affranchissant des algorithmes. C’est dans cette logique qu’Urbania a lancé son « micro-mag », un format 100% numérique mêlant les codes du magazine traditionnel avec les formats typiques du web : vidéos verticales, sondages, etc. Diffusés et hébergés sur son site, ils incarnent l’ambition du média de reconquérir son audience hors des écosystèmes dominés par les GAFAM.
Évidemment, difficile pour des rédactions indépendantes qui peinent déjà à boucler leurs comptes de se lancer dans le développement coûteux de fonctionnalités et de services pouvant rivaliser avec la Silicon Valley. Les rédactions ont tout intérêt à mutualiser leurs moyens — financiers, techniques et humains — pour produire des outils à leur service. Au Canada par exemple, une coalition d’une vingtaine de médias s’est rassemblée pour lancer une plateforme commune, Unrigged.ca, au lendemain de la décision de Meta de bannir l’information sur ses plateformes. Le site rassemble les articles, vidéos, newsletters et podcasts publiés par ses membres avec l’ambition de créer un nouvel espace de rencontre entre les lecteur·ices et leurs médias.
Archiver Internet pour protéger l’information
Au gré des achats et des fermetures, des sites d’information disparaissent brutalement, emportant avec eux des années de travail. Ce fut récemment le cas de MTV News ou de Game Informer, soulevant par la même occasion la question de la préservation de la mémoire numérique. Selon une étude du Pew Research Center, 38% des pages web accessibles en 2013 se sont évaporées, fragilisant le journalisme en ligne qui s’appuie souvent sur les hyperliens comme sources. Repenser l'avenir d'Internet implique donc de développer des systèmes robustes pour la préservation des contenus.
L’archivage est certes coûteux et demande des infrastructures solides dont ne disposent pas certaines rédactions, faute de moyens ou de volonté. En l’absence de solutions internes, ce sont alors les journalistes eux·elles-mêmes qui doivent souvent assumer cette tâche. Pourtant, les rédactions peuvent compter sur certaines initiatives pour assurer la préservation de leurs travaux. En France, la Bibliothèque nationale de France assure le dépôt légal du web, tandis qu’Internet Archive, actif depuis 1996, s’efforce de sauvegarder des centaines de milliards de pages en ligne. Mais face à l’ampleur de la mission et aux menaces – notamment les cyberattaques qui pourraient compromettre ces archives – une mobilisation collective est indispensable, comme le souligne Internet Archive lui-même dans son dernier rapport. Vous souhaitez contribuer à l'effort ? Cette page compile de nombreux guides et outils.
Ne plus subir Internet, mais le documenter
Un Internet plus sain repose sur un engagement collectif. Si les outils et infrastructures existent, encore faut-il que le public saisisse les enjeux et identifie les leviers d’action. Or, la presse a longtemps sous-estimé Internet comme objet politique et culturel majeur. Pourtant, l’actualité récente illustre son influence profonde et les conséquences d'en faire l’impasse. La dernière élection américaine en a été un rappel : Internet façonne la politisation d’une génération qui s’éloigne des médias traditionnels et se tourne vers des influenceurs. Considérer qu’il s’agirait d’un simple canal de diffusion serait une erreur et en faire un angle mort journalistique laisserait le champ libre aux acteurs de la désinformation et aux plateformes, sans régulation ni contre-pouvoir. La presse doit documenter ces transformations numériques pour créer une prise de conscience collective, d’autant plus que de nombreux·ses journalistes talentueux·ses s’y attellent déjà et n’attendent plus que les rédactions fassent appel à leurs services.
Réguler le terrain de jeu : le rôle des pouvoirs publics
La liberté de la presse et le droit à l’information se heurtent aux ambitions capitalistes des géants du numérique, dont le monopole s’est considérablement renforcé ces dernières années. Malgré toutes les initiatives citées précédemment, il semble illusoire de considérer que la presse indépendante et ses alliés soient capables d’inverser seuls cette tendance.
Face à un rapport de force déséquilibré, la régulation apparaît comme un levier essentiel. Ces dernières années, plusieurs outils juridiques y ont déjà contribué. Avec le RGPD, les internautes bénéficient d’un meilleur encadrement de l’usage de leurs données. Avec le Digital Markets Act (DMA) et le Digital Services Act (DSA), les grandes firmes comme TikTok, Google ou Meta sont soumises à des obligations en matière de modération ou de liberté. Mais ces protections doivent être renforcées face aux menaces et aux pressions exercées par les acteurs d’une partie de la tech américaine ainsi que Donald Trump. Les États généraux de l’information ont formulé un certain nombre de recommandations sur ce point, à l'image d'un « pluralisme effectif des algorithmes », défendu dans cette tribune, permettant pr exemple aux utilisateur·ices des réseaux sociaux de choisir librement un système de recommandation. La presse peut s’emparer davantage de ce sujet et se rassembler, comme elle l’a fait par le passé lors d’initiatives comme les États généraux de la presse indépendante, afin de pousser d'une même voix les pouvoirs publics et les représentant·es politiques à agir. Tandis que les grandes firmes de l’IA tentent par exemple d'imposer des négociations individuelles, l'unité reste assurément un levier clé dans la réapproprition d'Internet.
Pour aller plus loin :
- Comment Marsactu diffuse son offre numérique dans des espaces physiques
- Notre guide pour mieux comprendre l’Internet décentralisé et pourquoi une partie de la presse s’y intéresse
- Là où les libertés démocratiques sont menacées par la montée de l’extrême droite et où la concentration des médias fragilise la diversité de l’information, la mutualisation s’impose du côté des indés.
La newsletter de Médianes
La newsletter de Médianes est dédiée au partage de notre veille, et à l’analyse des dernières tendances dans les médias. Elle est envoyée un jeudi sur deux à 7h00.