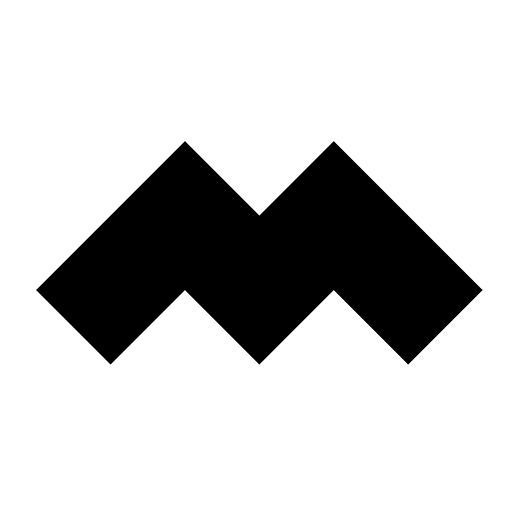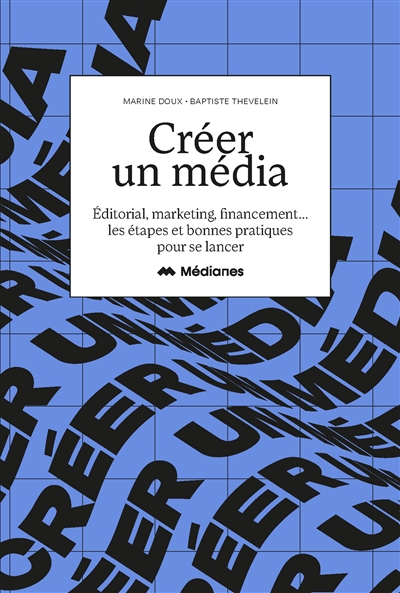Festival Imprimé 2023 : on refait le film
La deuxième édition du Festival Imprimé s’est tenue le 1er avril 2023, à Cenon, près de Bordeaux. Co-organisé par Médianes et Revue Far Ouest, l’événement a mis en avant un journalisme engagé et conscient des enjeux de son époque pour faire collectivement société.
Placer la transidentité au cœur des discussions féministes. Interroger le traitement médiatique de la désobéissance civile dans les mouvements écologistes. Parler rap, procès-bâillons, féminicides. Pour sa deuxième édition, le Festival Imprimé, organisé par Médianes et Revue Far Ouest n’est pas resté en surface. Les quatre tables rondes données au Rocher de Palmer, à Cenon (33) samedi 1er avril ont permis d'approfondir les enjeux écologiques et d'égalité dans le traitement journalistique, déjà abordés dans la première édition, pour trouver collectivement les moyens de construire de nouveaux modèles de société, plus inclusifs et plus durables. En voici un résumé.
Féminisme et transidentité : rendre aux personnes trans leur place dans l’espace médiatique
Table ronde animée par Clémence Postis (rédactrice en chef de Revue Far Ouest) avec Rachel Garrat-Valcarcel (journaliste politique pour 20 Minutes), Maud Royer (militante féministe du collectif #ToutesDesFemmes) et Lexie Agresti (militante féministe et fondatrice du compte Instagram @aggressively_trans).
En France, le nombre de personnes transgenres ou non-binaires s’élève à plus de 180 000. Cette part de la population reste loin de l’attention médiatique. Comment rendre aux femmes trans leur place dans les médias ? Une réflexion pour inclure celles et ceux qui composent la société mais en sont injustement méprisé·es ou invisibilisé·es.
Souvent considérées comme des objets de spectacle et réduites aux clichés qui leur ont été apposés, les personnes trans ne sont toujours pas incluses dans les sujets de fond, en particulier dans les rubriques Politique et Société. « Il est temps de sortir de la sidération », appelle la journaliste Rachel Garrat-Valcarcel, soulignant les nombreuses difficultés concrètes auxquelles sont confrontées les personnes trans dans leur quotidien comme se loger, trouver un emploi ou accéder à des soins. D’autant que cette invisibilisation peut empêcher certaines personnes d'effectuer leur transition de genre par absence de modèle.
De son côté, Lexie Agresti, fondatrice du compte Instagram @aggressively_trans, confie recevoir des menaces de mort tous les jours en raison de la parole engagée et indépendante qu’elle porte. C’est d’ailleurs en raison de nouvelles menaces que Lexie Agresti a renoncé à intervenir sur place, à Bordeaux, à nos côtés, et est intervenue par visio-conférence. Aujourd’hui, seuls les réseaux sociaux offrent aux personnes trans la possibilité de faire entendre leurs voix dans l’espace public. L’absence de légitimation dans les médias traditionnels marginalise cette partie de la population et nourrit des tensions dues à un manque d’éducation sur ces sujets. Or, s’opposer aux personnes trans revient à s’opposer « en général, à toute avancée sur les questions de genre ainsi qu’aux féministes », dénonce la militante Maud Royer.
Supprimer des droits aux personnes trans fait forcément reculer la cause féministe. Pas de féminisme sans femmes trans, donc. Car pour celles-ci aussi, le regard qui leur est porté est misogyne. « Les femmes trans vont devoir payer le prix que payent toutes les femmes si elles ne sont pas féminines, si elles sont violentes, si elles prennent trop de place. », rappelle Maud Royer. Point commun à toutes ? La domination patriarcale.
⟶ Pour retrouver l’intégralité du live-tweet de cette conférence, rendez-vous sur le compte Twitter du Festival Imprimé.
Quand les médias rap donnent une voix à la culture populaire
Table ronde animée par Marine Slavitch (journaliste chez Médianes) avec Lise Lacombe (cofondatrice du magazine rap Mosaïque), Mekolo Biligui (journaliste indépendante et chroniqueuse pour l’émission rap La Récré) et Emmanuelle Carinos Vasquez (doctorante en sciences sociales, spécialiste du rap français et journaliste pour L’Abcdr du son).
Année après année, l’industrie du rap n’en finit pas de monopoliser le Top 50 des titres les plus écoutés en France. Pour autant, dans les médias, ce style de musique continue d’être abordé sous le prisme de la violence, quand il n’est pas tout simplement snobé par les cérémonies musicales. Pour compenser ce traitement, le rap s’est créé au début des années 2000 ses propres médias : des petits blogs spécialisés lancés par des fans et devenus, au fil du temps, des incontournables de la culture populaire. On peut notamment citer l'Abcdr du Son et Booska-p.
Leur succès leur permet aujourd’hui d’informer sur des enjeux de société plus larges, allant de l’islamophobie aux violences sexistes et sexuelles. Comment les médias rap sont-ils parvenus à toucher un public que les médias traditionnels peinent toujours à atteindre ?
Si le rap se fraye de plus en plus un chemin dans les pages des médias généralistes, on n’en parle pas forcément mieux. Souvent, le rap est traité via l’angle politique. « C’est une déformation que la presse généraliste fait souvent. Le rap n’est pas intéressant seulement parce que des pauvres parlent de leur mode de vie. C’est un art », souligne la chercheuse Emmanuelle Carinos. Du fait de cette incompréhension, les artistes issu·es de l’industrie du rap délaissent la presse généraliste et privilégient la promotion sur leurs réseaux sociaux personnels, devenant ainsi « leurs propres médias », relate la journaliste Mekolo Biligui.
Suivant la même logique, certain·es passionné·es de rap se sont mis à créer leurs propres lieux d’expression pour informer sur cette industrie. « Des médias spécialisés sont nés sur les réseaux, c’est une économie influente qui marche », note Lise Lacombe, cofondatrice du magazine Mosaïque. Ce qui plaît au public, c’est le lien de proximité, l’authenticité et la culture familiale que ces médias spécialisés entretiennent avec les artistes, loin du mépris et de l’incompréhension des médias traditionnels.
Mais ces relations quasi amicales — quand elles ne sont pas financières — créent parfois un problème de dépendance des médias envers les labels. « Être payé par les labels, même si explicitement dit, est un problème, regrette Emmanuelle Carinos. Être indépendant ou bénévole permet de parler de qui on veut, et surtout, de ce qui ne nous plaît pas. Je trouve que l’on manque de critiques aujourd’hui. »
⟶ Pour retrouver l’intégralité du live-tweet de cette conférence, rendez-vous sur le compte Twitter du Festival Imprimé.
Écologie et désobéissance civile : quel est le rôle des médias ?
Table ronde animée par Millie Servant (rédactrice en chef du magazine Climax) avec Patrick Maupin (militant écologiste chez Greenpeace Bordeaux), Léna Lazare (Porte-parole en France du mouvement Youth for Climate et membre du collectif Les Soulèvements de la Terre) et Laury-Anne Cholez (journaliste pour Reporterre).
Bloquer la construction des méga-bassines ; s’introduire dans des réunions privées ; s’enchaîner aux grilles d’un aéroport ; dégonfler les pneus des SUV. Les actes de désobéissance civile sont nombreux pour alerter sur l’urgence climatique et nous rappeler que nous tenons entre nos mains l’avenir de la planète. Pourtant le fatalisme, largement nourri par un discours du découragement, tend à infuser le débat public, favorisant ainsi l’inaction.
Face à cela, des mouvements de citoyen·nes émergent pour mettre en exergue l’inaction politique et citoyenne. Mais la mobilisation de ces forces vives souffre trop souvent d’un traitement médiatique insuffisant ou erroné… Quel rôle pour les médias, dans un contexte d’urgence climatique ?
Il convient d’abord de définir la désobéissance civile. Léna Lazare explique ces passages à l’action comme le fait de « considérer qu’on n’a pas d’autre choix que de dépasser le cadre légal pour faire bouger les choses. On estime ainsi que nos actions sont tout à fait légitimes face aux ravages écologiques en cours. »
Si les luttes contre les méga-bassines à Sainte-Soline durent depuis six ans, la manifestation du samedi 25 mars a de spécifique qu’elle a été le théâtre d’affrontements violents avec plus de 200 personnes blessées. « Aujourd’hui, un contre-discours commence à émerger dans certains médias comme Reporterre mais dans la presse généraliste, ces actions ont été présentées comme venant de black blocs voulant casser du flic. », commente la journaliste Laury-Anne Cholez. La raison de ce décalage ? L’appartenance des journalistes aux classes dominantes. « En tant que journaliste, socio-culturellement, financièrement, tu évolues dans une sphère ultra-privilégiée. Tu n’as aucun intérêt à remettre en cause les fondements qui font que tu es en haut de la pyramide », poursuit la journaliste de Reporterre.
Pour faire évoluer le traitement médiatique de ces luttes écologiques, il convient d’abord de changer de discours. « Le choix des mots est important, estime Millie Servant. Détruire quelque chose construit par l’Homme, c'est du vandalisme, détruire quelque chose construit par la nature, c'est du progrès. » Puis, de prendre du recul. « Le travail d'un journaliste, ce n’est pas de juger, c’est de se demander pourquoi les gens agissent comme ils le font, c’est d’analyser. Moi, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour raconter », conclut Laury-Anne Cholez.
⟶ Pour retrouver l’intégralité du live-tweet de cette conférence, rendez-vous sur le compte Twitter du Festival Imprimé.
La presse indépendante peut-elle résister face aux puissants ?
Table ronde animée par Camille Polloni (journaliste chez Mediapart, administratrice du Fonds pour une presse libre et partenaire du Festival Imprimé) avec Sophie Le Gall (rédactrice en chef de Cash Investigation), Leïla Miñano (journaliste, secrétaire générale du média d’enquêtes Disclose) et Antoine Champagne (rédacteur en chef du site d’investigation Reflets.info).
Patrick Drahi contre le média Reflets.info, Gaël Perdriau contre Mediapart, Thierry Kovacs contre Mediacités. Sur l’année écoulée, les médias ont eu à faire face à de nombreuses procédures-baillons : des attaques en justice pour empêcher la presse de faire son travail d’investigation. Rapports de pouvoir, dysfonctionnements au sein des institutions, injustices, comportements abusifs… Des attaques qui servent un phénomène : la concentration des médias et l’étouffement de la presse indépendante. Celle-ci peut-elle résister face aux puissants ?
Mediapart dépense chaque année 200 000 € en frais légaux pour se défendre, rappelle Camille Polloni. D’où la nécessité de peser et de vérifier chaque mot d’un article à charge. « On discute de nos articles non plus seulement avec un rédacteur ou une rédactrice en chef mais on le fait valider par un avocat. À chaque convocation, à chaque envoi de questions par e-mail, on est avec notre avocat », souligne Leïla Miñano, journaliste chez Disclose. Une pression judiciaire énorme qui fait parfois reculer des médias et les empêche de publier certaines informations, faute de moyens suffisants.
Face à des milliardaires comme Patrick Drahi, Antoine Champagne, rédacteur en chef de Reflets.info a ainsi eu recours à une levée de fonds pour financer ses frais de justice. « On pourrait changer les choses et dire que lorsqu'une entreprise perd contre un journal, elle prend en charge ses frais de justice », estime le journaliste. Comme Mediapart face au maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau, Reflets.info a connu une censure préalable [fait de censurer un article avant même sa publication, NDLR.] sur ses révélations sur Patrick Drahi, les accusant de violation du secret des affaires. Des contournements du droit de la presse qui tendent à augmenter depuis quelques temps.
Ces procédures-bâillons envoient également un message alarmant aux sources des journalistes. « C’est extrêmement angoissant de se rendre compte qu’on a exposé la source à de potentielles représailles », dénonce Leïla Miñano. D’autant que les médias entrent parfois dans le jeu des puissants. « On n’est pas dupes de certains médias qui font toujours le même type de papiers contre nous. On a vu arriver, notamment dans le cas de Lidl [une enquête de l’émission sur les coulisses de l’enseigne allemande et ses conditions de travail, NDLR.], dans les dossiers judiciaires, des papiers qui nous dénigraient », affirme Sophie Le Gall, rédactrice en chef de Cash Investigation.
⟶ Pour retrouver l’intégralité du live-tweet de cette conférence, rendez-vous sur le compte Twitter du Festival Imprimé.
Féminicides : une incompréhension médiatique
Table ronde animée par Amandine Sanial (journaliste chez Revue Far Ouest) avec Laurène Daycard (journaliste et autrice de Nos Absentes, à l’origine des féminicides) et Sarah Barukh (autrice de 125 et des milliers).
Elles s’appelaient Salomé, Géraldine, Myriam ou Sylvia. Comme plus de 2 000 autres femmes en l’espace de quinze ans, elles ont été tuées par leur conjoint, ou ex-conjoint. Si les féminicides ont été érigés en « grande cause du quinquennat », l’État échoue encore à protéger les femmes de la violence masculine. Les médias ont aussi leur part de responsabilité en traitant les affaires sous l’angle du fait divers quand il s’agit d’un problème systémique : pourquoi publier des photos de mariage pour illustrer un féminicide ? Écrire que « rien ne laissait présager un tel drame » quand la victime avait porté plainte plusieurs fois ?
En France, les féminicides ont longtemps été attachés « à l’expression d’une passion en rapprochant des notions qui n’ont rien à voir : l’amour, la possession et la violence », dénonce Laurène Daycard. D’où les fameux « crimes passionnels », formules trop souvent lues dans les rubriques Faits divers des médias traditionnels.
En s’appuyant sur sa propre expérience des violences conjugales, Sarah Barukh a voulu, dans son ouvrage 125 et des milliers, « raconter ce qui faisait des victimes des êtres singuliers qui ont été aimés, avaient des rêves. » Un moyen de sortir des statistiques, qui, bien que nécessaires, peuvent parfois déshumaniser les victimes de ces crimes. Avec Nos Absentes, Laurène Daycard a travaillé sur l’origine des féminicides, qu’elle qualifie de maladie sociétale : « la violence conjugale fonctionne comme une prise d’otage de l’intime dans laquelle la victime est placée pendant des mois, des années. Cela prend plusieurs formes : violences financières, micro-régulation du quotidien, contrôle des tâches ménagères... »
⟶ Pour retrouver l’intégralité du live-tweet de cette conférence, rendez-vous sur le compte Twitter du Festival Imprimé.
NDLR : Médianes, le studio, accompagne Climax (Millie Servant) dans son développement stratégique et Youpress (Leïla Miñano/Disclose) dans le lancement de l'enquête Femmes à abattre. Médianes co-produit aux côtés de la Revue Far Ouest le Festival Imprimé.
Vous pouvez retrouver le programme détaillé de l'événement et la liste de nos partenaires sur le site du Festival Imprimé.
La newsletter de Médianes
La newsletter de Médianes est dédiée au partage de notre veille, et à l’analyse des dernières tendances dans les médias. Elle est envoyée un jeudi sur deux à 7h00.