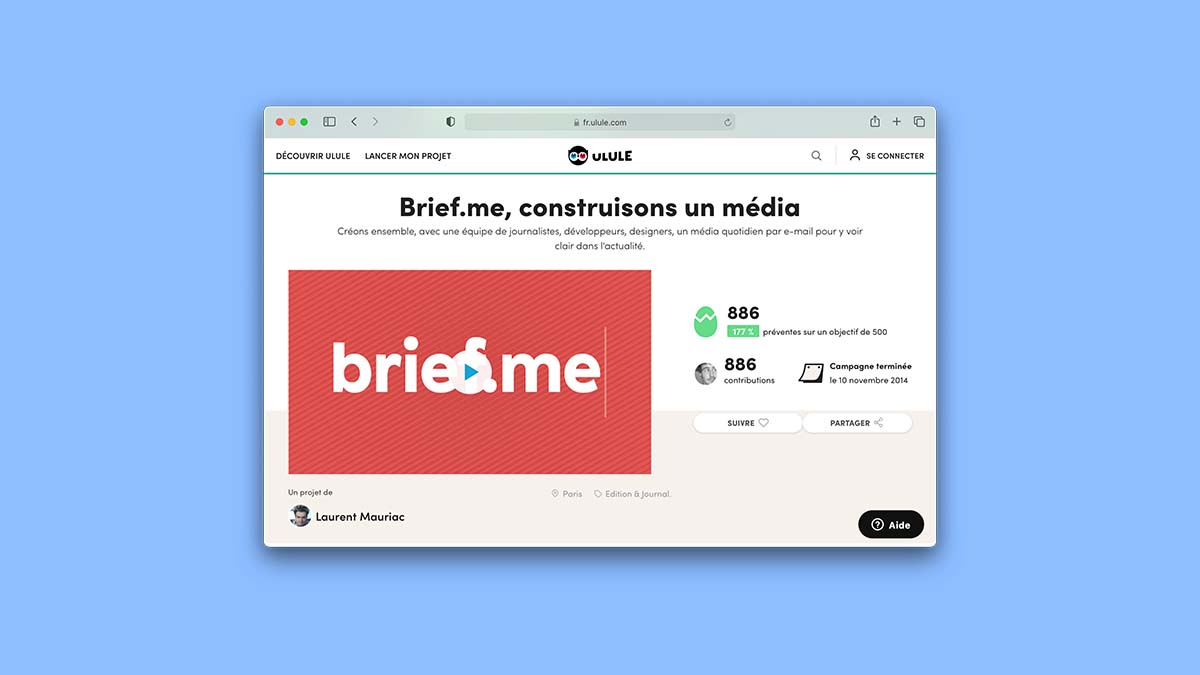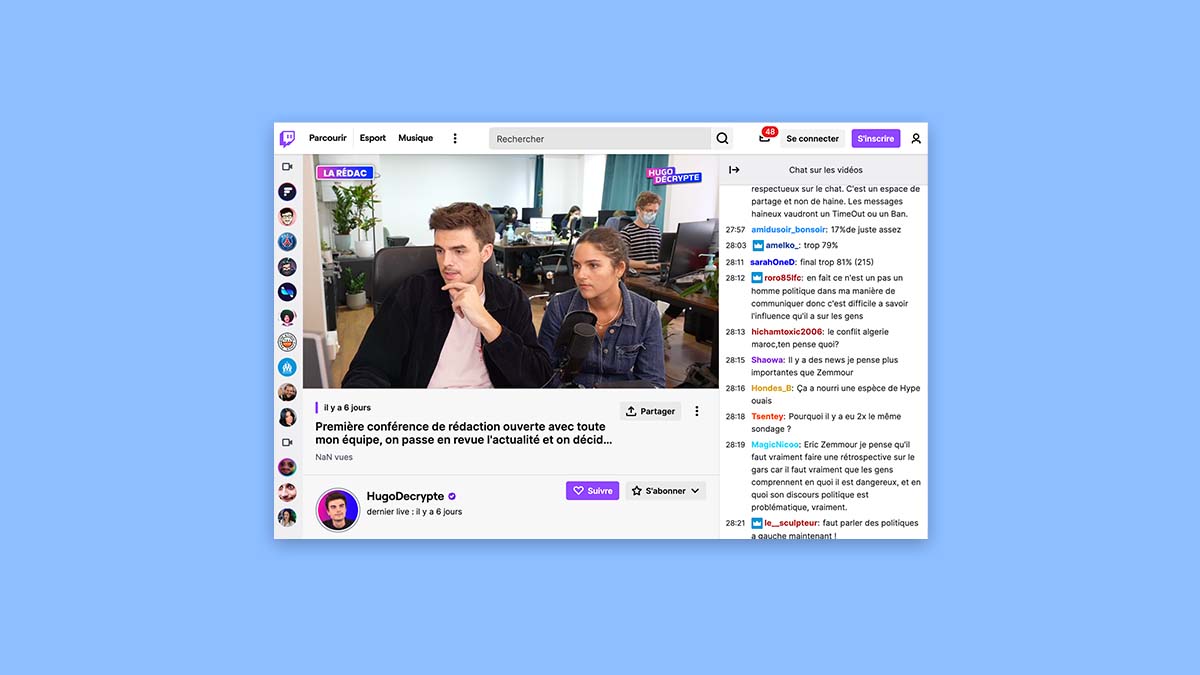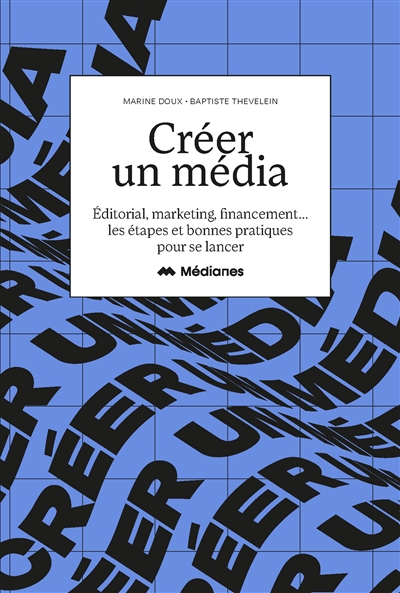Ouvrir la voix : le Festival Imprimé, pour un journalisme engagé
Le 26 mars dernier, le Festival Imprimé, organisé par Médianes et Revue Far Ouest, a réuni journalistes, auteur·rices et créateur·rices de contenus dans une ancienne ferme à proximité de Bordeaux. Leur point commun ? Tous·tes défendent un journalisme capable de réhabiliter les sujets délaissés par le politique, et aussi, peut-être, par certains médias.
Écologie, féminismes, justice sociale… À quelques jours de l’élection présidentielle, il nous a paru urgent de prendre le temps d’échanger sur ces thématiques qui nous sont chères avec celles et ceux qui en ont fait une priorité éditoriale. Dans une série de cinq tables rondes, Médianes et la Revue Far Ouest ont donné la parole aux médias défendent un journalisme engagé. Alors comment ils et elles trouvent les moyens d’« imprimer » ces discours dans notre société, dans les esprits et sur le papier ? Éléments de réponse.
Journalisme d’investigation : (en)quête de risque ?
Violences sexistes et sexuelles, corruption, affaires d’État : les journalistes enquêtent sur le terrain et révèlent au grand jour les faits, gestes et mécanismes de notre société. Par leurs écrits, ils et elles viennent bousculer l’ordre établi, mettent en lumière des phénomènes de grande ampleur et transforment de ce fait la société. « Juge », « procureur », au-delà de leurs écrits, leur rôle est très souvent critiqué.
C’est pourquoi ce 26 mars, nous souhaitions en apprendre davantage sur leur conception du journalisme et les conditions d’exercice de leur travail. Interrogé par Jean Berthelot de La Glétais, journaliste co-créateur de Podcastine, Patrick de Saint-Exupéry, cofondateur de XXI et de la revue 6Mois, directeur de collection aux Arènes, déclarait volontiers que le « ressort du journalisme, c’est la curiosité ». Pour lui, le journaliste n’est pas un juge mais bien plutôt un « passeur ». Membre du collectif Youpress, Sophie Boutboul, qui écrit sur les violences sexistes et sexuelles, affirme de son côté que l’enquête ne s’apprend pas à l’école, d’où l’importance du terrain : « les moyens techniques ne doivent pas remplacer une présence sur place ». Les trois invité·es ont pointé les problèmes liés à la concentration des médias et à leur gestion par certains patrons de presse.
Les médias seraient tantôt une « arène de combat », une « arme au service d’un projet précis » (Patrick de Saint-Exupéry), tantôt le « lieu privilégié de pressions internes » — au sein de rédactions non indépendantes —, déclare de son côté Pauline Bock, journaliste chez Arrêt sur images. Cette dernière réaffirme par ailleurs la nécessité de « recouper les sources » pour enquêter correctement. Une mission qui se heurte au temps de l’enquête, qui, selon Patrick de Saint-Exupéry est devenu un luxe : « ceux qui peuvent en bénéficier ont une énorme chance. »
Et pour cause : le métier de journaliste d’investigation se fragilise, de surcroît chez les pigistes qui doivent gérer leur comptabilité (Pauline Bock) et consacrer une grande partie de leur temps, non rémunéré — faute de salaire fixe —, aux procédures juridiques (Sophie Boutboul).
⟶ Pour retrouver l’intégralité du live-tweet de cette conférence, rendez-vous sur le compte Twitter de Médianes.
Écologie : Dire l’indicible
Flo Laval a cofondé la Revue Far Ouest. Ce média a plusieurs ambitions, notamment celle d’échapper à la traditionnelle logique de rubriquage dans la presse, elle qui a tendance à faire d’un sujet comme l’écologie une thématique plutôt qu’un pré-requis éditorial… Alors c’est assez naturellement que pour cette seconde table ronde, Flo Laval a invité des intervenant·es à s’exprimer autour de la question suivante : « Écologie : peut-on sortir du déni ? ». Juliette Quef, présidente de Vert, Salomé Saqué, journaliste économie et politique chez Blast et Vincent Mignerot, essayiste et président d’honneur d’Adrastia — une association qui veut « anticiper et préparer le déclin de la civilisation thermo-industrielle de façon honnête, responsable et digne »—, auteur de L’Énergie du déni : Comment la transition énergétique va augmenter les émissions de CO2, se sont réuni·es autour de la table : changement climatique, pollution, catastrophes écologiques…
Les signes d’un effondrement écologique sont partout. Pourtant, la menace ne semble pas être prise au sérieux. Manquons-nous d’informations ? Pour Juliette Quef, cela ne fait aucun doute : les journalistes ont un pouvoir d’action non négligeable. Le problème, c’est l’effet d’agenda qui a tendance à orienter l’attention du public, pointe Salomé Saqué en rappelant que le premier volet du rapport du GIEC est sorti en même temps que… le transfert de Lionel Messi au PSG.
Les choix liés à la couverture médiatique des questions écologiques ont tendance à répondre à des critères arbitraires, d’autant plus quand le coup médiatique est privilégié par rapport à l’intégration des journalistes spécialisé·es aux débats. Pourtant « le journalisme, c’est informer les citoyens de ce qui est d’intérêt général, afin que l’on puisse collectivement résoudre les problèmes prioritaires » poursuit la journaliste de chez Blast. Les ressorts de ce déni médiatique sont pluriels ; pour Vincent Mignerot, il est même le fruit d’une demande, quoiqu’inconsciente : « On ne veut pas se poser la question de la provenance de ce qui fait notre confort. » Les solutions existent, défend Juliette Quef, qui milite de son côté pour que les journalistes montent en compétence sur ces sujets. « Chez Vert, on est pour réconcilier médias et citoyens autour d’un manifeste engageant. » Prometteur.
⟶ Pour avoir accès aux échanges de cette deuxième table ronde, rendez-vous sur notre live-tweet.
Féminismes : Donner la parole
Au sein de l’écosystème médiatique, l’imposition de filtres liés à une conjoncture largement patriarcale a tendance à asphyxier la parole féministe. Interrogées par Amélie Coispel, membre des associations Médianes et Les Internettes, Axelle Jah Njiké fondatrice du podcast Me My Sexe and I, Léa Chamboncel, journaliste et podcasteuse, autrice de Plus de femmes en politique !, et Léa Drouelle, journaliste et cofondatrice de Sorocité se sont exprimées autour de la circulation médiatique de la parole féministe.
Le podcast devient une « radio libre » (Léa Chamboncel), le seul canal susceptible d’offrir une caisse de résonance significative aux voix minoritaires. En tant que femme noire, Axelle Jah Njiké affirme qu’elle « n’avai[t] pas de place ailleurs. (…) Le fait qu’[elle] occupe simplement l’espace est politique. » Puisqu’il offre une nouvelle fenêtre d’expression, le podcast autorise une certaine cohérence entre le discours et les pratiques, ainsi qu’une maîtrise de l’angle féministe. Léa Drouelle déplore à ce titre qu’au sein du débat public « on interdise l’usage du point médian tout en encourageant la féminisation des métiers. ».
Si Léa Chamboncel pose la question de la rémunération, elle fait front contre la notion de « média lucratif ». Bien qu’il soit certain que les journalistes doivent être rémunérés pour leur travail selon elle, « un média n’est pas une entreprise classique ». Celle qui a décidé de baser son modèle de financement sur les contributions des auditeur·rices l’a fait dans un but : rester indépendante. Et être indépendante, c’est aussi prendre le risque de voir ses idées reprises par les médias mainstream. Tout cela arrive sans que les productrices du contenu ne perçoivent de salaire, rappelle Axelle Jah Njiké.
Alors, les nouveaux médias peuvent-ils changer la donne ? « Les “nouveaux médias” n’ont souvent de nouveau que le nom. Les mécanismes sont anciens, ce sont les mêmes personnes derrière » poursuit-elle. Et si la force de la voix féministe, c’était sa capacité à politiser un témoignage ? « Une fois qu’on en parle, on réalise que c’est un sujet systémique » déclare Léa Drouelle.
Rendez-vous sur notre compte Twitter pour en savoir plus sur cette table ronde.
Comment raconter la France ?
Reportages, immersions, sondages, représentativité des rédactions… Avec Manon Boquen, fondatrice et rédactrice en chef de la revue Pays, François Vey, rédacteur en chef de Zadig, Inès Belgacem, rédactrice en chef adjointe de StreetPress, nous nous sommes demandé·es s’il était possible de parler à tous·tes les Français·es et s’il existait des solutions éditoriales et stratégiques pour raconter la France.
La France ou les Frances, d’ailleurs ? C’est la question que pose en creux Clémence Postis, rédactrice en cheffe de la Revue Far Ouest, média ancré dans le Sud-Ouest, et modératrice de cette quatrième table ronde consacrée à la mise en récit de la France.
Le rapport des individus à leur territoire est inscrit dans un système de rapports de force qui se lisent sur le papier. C’est en tout cas le constat que semble faire Inès Belgacem qui revendique, avec le projet porté par StreetPress, le besoin de mettre en lumière celles et ceux dont on ne parle pas plutôt que les « “expert·es trouvés au débotté” (…) On va donner la parole aux premier·es concerné·es qui vont nous parler de leur quartier, de leurs problèmes, avec peut-être plus de réalité. »
Pays de son côté s’intéresse tous les six mois à un unique territoire en procédant à « une mise en mots de la France ». Le projet est né suite au mouvement des Gilets Jaunes, quand Manon Boquen a fait le constat que la concentration des journalistes à Paris était plus qu’un enjeu théorique : « J’étais choquée que des journalistes parisiens ne comprennent pas ce que pouvait être la vie ailleurs(…) Pour l’information et la représentation, le rôle des journalistes locaux est important, il faudrait que les grandes rédactions aient aussi davantage de correspondant·es en régions. »
C’est aussi pour cela que Zadig a pris le parti pris de documenter la France en dehors de l’actualité, et sous toutes ses facettes. Pour François Vey, il était urgent de raconter les histoires des Français·es « inaudibles » vivant dans une France « invisible ». C’est le travail conjoint d’écrivain·es, d’intellectuel·les, de photographes et d’illustrateur·rices qui a donné naissance à Zadig. Les illustrations sont d’ailleurs pour François Vey une manière de « se démarquer de l’ensemble de la production littéraire et journalistique qu’on peut trouver en librairie ». On en prend bonne note.
Les temps forts de la table ronde sont à retrouver sur notre compte Twitter.
L’avenir de la gauche : refuser l’ordre établi ?
Pour clore cette première édition du Festival Imprimé, il semblait nécessaire de revenir sur les motivations qui ont conduit à l’organisation d’un tel événement. Le 26 mars, on interrogeait le métier de journaliste, l’exercice qui encadre l’activité liée à la production des informations et un droit de tout un chacun·e : celui de savoir et d’avoir accès aux savoirs.
Pour Edwy Plenel, président et cofondateur de Mediapart, ce droit est sans doute plus important que le droit de vote. Mais dans quelques semaines, pourra-t-on encore défendre un journalisme engagé ? C’est la question que pose Annabelle Perrin, cofondatrice de La Disparition, un média qui chronique les disparitions en cours dans notre monde. Qui de mieux pour interroger celle de la gauche ?
À son micro, Edwy Plenel a en effet débattu avec Rachid Laïreche, journaliste politique à Libération, autour de la gauche et de son avenir : idéaux, valeurs, combats, partis politiques… Qu’en reste-t-il ? Pour Rachid Laïreche « la gauche d’aujourd’hui est une gauche qui veut plaire à la droite ». Edwy Plenel semble de son côté semble croire en la construction d’un nouvel imaginaire : « la gauche ne va pas disparaître, car c’est un mouvement permanent d’émancipation, dont le moteur est les droits. ». Si elle est celle que dépeint Richard Laïreche « une gauche sérieuse et ordonnée qui a tendance à s’oublier », le rôle critique des médias ne doit-t-il pas plus que jamais être réhabilité ? Demain, comment sera abordée la question de la neutralité journalistique ? « On ne demande pas au journaliste de penser politiquement juste, mais d’informer en pensant contre lui-même ». Et c’est signé Edwy Plenel, évidemment.
Pour retrouver les temps forts du débat, rendez-vous ici.
La newsletter de Médianes
La newsletter de Médianes est dédiée au partage de notre veille, et à l’analyse des dernières tendances dans les médias. Elle est envoyée un jeudi sur deux à 7h00.